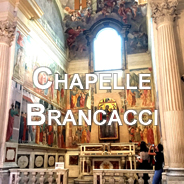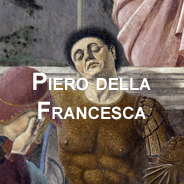Galerie Palatine du Palais Pitti et Jardin de Boboli
Palais Pitti
Le palais, qui abrite plusieurs musées importants, fut construit dans la seconde moitié du XVe siècle peut-être sur un projet de Filippo Brunelleschi pour Luca Pitti, mais il resta inachevé à la mort de ce dernier en 1472. L’attribution du projet à Brunelleschi est pourtant contestée, car le style massif de ce bâtiment n’est pas du tout dans la ligne humaniste des architectures de Brunelleschi. Par contre le style de la façade ressemble à celle du Palais Medici-Riccardi, construit entre 1444 et 1459 par Michelozzo, qui étudia effectivement l’architecture chez Brunelleschi. Certains pensent que l'architecte aurait été Luca Fancelli, un élève peu connu de Brunelleschi, plus tourné vers l'architecture domestique. Car aussi grandiose et pompeux que soit le Palais Pitti, il faut reconnaître que son architecture est austère et la légèreté habituelle des créations de Brunelleschi et théorisée par Leon Battista Alberti et fait cruellement défaut.
Mais qu’on ne s’y trompe pas : le bâtiment d'origine, formé de deux étages et d'un rez-de-chaussée avec seulement cinq fenêtres à chaque étage, et la famille Pitti, ruinée après la mort de Luca Pitti chercha à le revendre. Ironiquement, il fut acheté en 1550 par Eleonora da Toledo, épouse du grand-duc Cosimo I de Medici, devenant ainsi la résidence officielle de la famille. Un corridor est alors construit par Giorgio Vasari pour relier le Palazzo Pitti au Palazzo Vecchio de l’autre côté de l’Arno. Ce corridor existe encore aujourd’hui et pas par l’étage du Ponte Vecchio, permettant de relier les deux musées du Palais Pitti et des Offices. Il vient d’ailleurs d’être complètement rénové et réaménagé.
Le palais fut agrandi et transformé, en 1560 par Bartolomeo Ammannati. Ammannati réorganise également l'intérieur et agrandi les ailes, la partie noble du Palais se tournant maintenant vers le jardin dont la construction a commencé.
En ce qui concerne la vie domestique à l'intérieur du palais, nous savons qu'il abritait plusieurs composantes de la famille, réparties dans différents appartements privés. Les pièces de l'aile gauche appartenaient au grand-duc, tandis que celles de droite étaient utilisées par l'héritier. Les ailes latérales abritaient les appartements de leurs épouses. Les pièces du deuxième étage abritaient la grande bibliothèque, tandis que les pièces latérales étaient réservées aux enfants. Le côté gauche, au rez-de-chaussée, abritait l'appartement que le Grand-Duc utilisait en été.
Il fut à nouveau agrandi au début du XVIIe siècle par Giulio et Alfonso Parigi. Ces deux derniers architectes donnèrent à la façade son aspect actuel, à l'exception des deux pavillons latéraux en saillie, construits à l'époque des Lorraine et achevés dans la première moitié du XIXe siècle par Paoletti et Poccianti, qui construisirent également la Palazzina della Meridiana, ajoutée à la partie arrière du palais donnant sur le jardin.
La plupart des décorations intérieures furent également exécutées au XVIIe siècle par Giovanni da San Giovanni, Pietro da Cortona, Il Volterrano, Antonio Domenico Gabbiani et Sebastiano Ricci.
Le Palais Pitti servit aussi au XVIIIe siècle de centre de commandement à Bonaparte.
En 1860 la Maison de Savoie prend possession du bâtiment. Florence devient la capitale de l’Italie unifiée en 1865 et c’est dans ce palais que Victor-Emmanuel établit son siège royal. L’Italie en effet n’a pas encore englobé les États pontificaux, et il faudra attendre le 30 juin 1871 pour la capitale italienne soit définitivement transférée à Rome.
Devenu demeure royale, le palais est étendu vers le jardin Boboli puis une majestueuse cour intérieure est dessinée.
Aujourd'hui, le palais et les jardins de Boboli abritent la Galerie Palatine, le Musée de l'Argenterie, le Musée d'Art Moderne, la Galerie des Costumes, le Musée de la Porcelaine et le Musée des Carrosses.
Galerie Palatine
La Galerie Palatine doit son nom au fait qu'elle se trouve dans le palais de la famille régnante et fut ouverte au public par la Maison de Lorraine en 1828. Aujourd'hui encore, elle conserve la disposition typique d'une collection privée, avec une combinaison somptueuse de décorations intérieures et de riches cadres originaux.
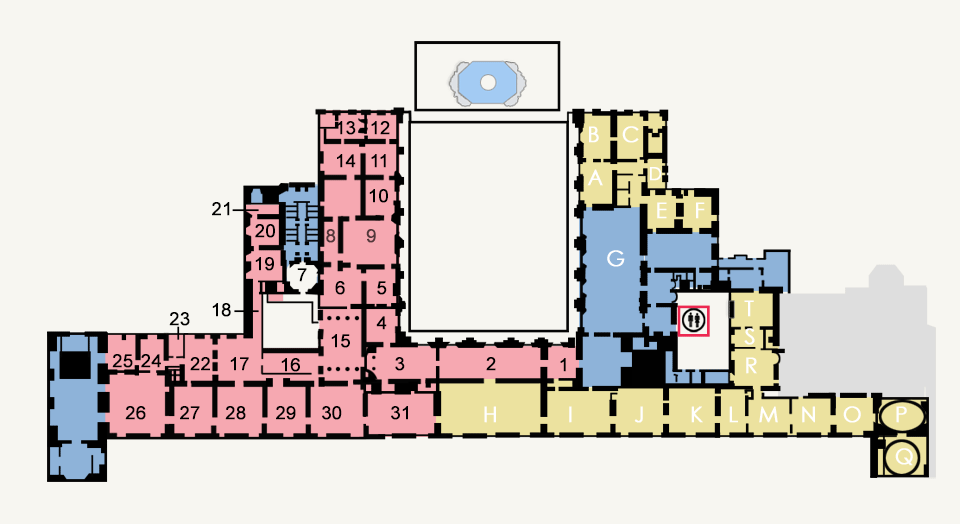
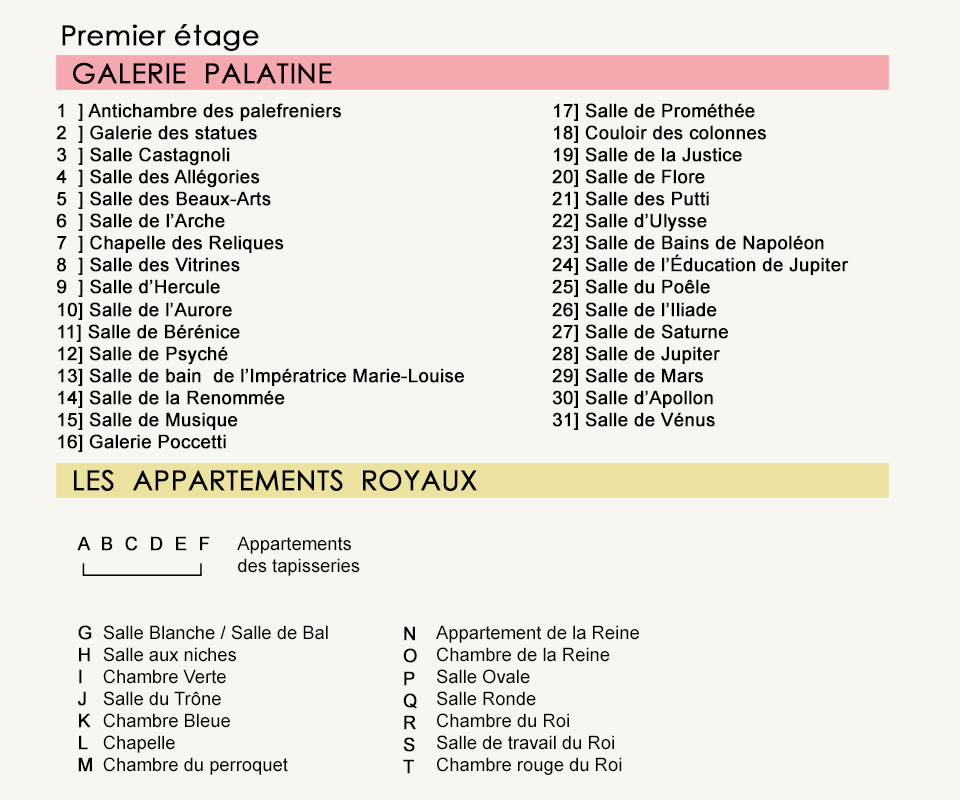
Contrairement à la plupart des musées réorganisés ces derniers temps, la Galerie Palatine ne suit pas un ordre chronologique ni des écoles de peinture, révélant au contraire la richesse et le goût personnel des habitants du palais. On accède aux salles qui abritent la galerie par l'escalier érigé par Ammannati. À l'époque des Médicis, ces salles constituaient les appartements du Grand-Duc et ses salles d'audience. Elles sont partiellement décorées de fresques de Pietro da Cortona (1596-1669) avec un imposant cycle décoratif qui fait appel au mythe classique pour faire allusion à la vie et à l'éducation du Prince. Cet ensemble de fresques et de stucs, peut-être l'exemple le plus représentatif du baroque florentin, offre un cadre splendide aux œuvres exposées allant du XVIe au XVIIe siècle.
L'un des groupes d'œuvres les plus significatifs de la collection est constitué par les œuvres de Titien et de Raphaël, qui furent reçues par les Médicis par le testament de Vittoria della Rovere, dernière fille des ducs d'Urbino et épouse de Ferdinand II de Médicis. Il suffit de rappeler le Portrait d'un gentilhomme et de Madeleine de Titien, et la Madone du grand-duc, la Madone à la chaise, les portrait de Maddalena Doni ou encore la Velata de Raphaël.
La Galerie offre également un panorama complet de la peinture européenne du XVIIe siècle, avec des œuvres très célèbres comme les tableaux de Rubens (Les quatre philosophes, L'Allégorie de la guerre), le portrait du cardinal Bentivoglio de Van Dyck, les portraits de Giusto Sustermans, qui représentent certaines personnalités de la famille grand-ducale, la Vierge à l'Enfant de Murillo, l'Amour endormi et le Cavadenti (l’arracheur de dents) de Caravage, et d'autres portraits de Frans Pourbus ou de Velazquez. On y trouve également des œuvres plus anciennes, toutes très exceptionnelles, peintes par Bronzino, Fra Bartolomeo, Piero del Pollaiolo et Filippo Lippi.
Certaines des salles les plus importantes, du point de vue historique et artistique, sont la Salle de Musique décorée et meublée dans un style néo-classique ; la salle des Putti entièrement dédiée à la peinture flamande et la salle des Poêles, chef-d'œuvre de Pietro da Cortona qui la peignit en 1637 avec les Quatre Âges de l'Homme, commandés par les Médicis, qui représentaient l'inauguration de la saison baroque pour l'école de peinture florentine.
Jardin de Boboli
Le jardin, qui s'étend de la colline derrière le Palais Pitti jusqu'à la Porta Romana, a atteint son extension et son aspect actuels, devenant l'un des plus grands et des plus élégants jardins à l'italienne, grâce à plusieurs phases d'agrandissement et de restructuration réalisées à différentes époques. Les premiers travaux concernèrent d'abord la zone la plus proche du palais, après que le bâtiment ait été acheté par Cosme Ier de Médicis et par sa femme Eleonora di Toledo, qui avaient choisi cet endroit pour le nouveau palais grand-ducal. Le plan initial fut dessiné par Niccolò Tribolo, mais les travaux furent complétés, après sa mort en 1550, par d'autres architectes, dont Giorgio Vasari (de 1598 à 1561) ainsi que Bartolomeo Ammannati et Bernardo Buontalenti sous le règne de François Ier, qui succéda à son père Cosme.
Les Médicis et les Lorraine continuèrent à enrichir et à agrandir le jardin également aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Outre l'ajout de belles prairies, d'allées, de petits bosquets et de belles vues panoramiques, ils ont enrichi le jardin en y ajoutant d'extraordinaires complexes décoratifs, constituant ainsi un musée en plein air qui exposait à la fois des statues romaines et des XVIe et XVIIe siècles.
La première phase a conduit à la création d'un "Amphithéâtre" adossé à la colline derrière le palais. L'amphithéâtre primitif, formé initialement de "bords et de prairies toujours vertes", a ensuite été remplacé par un amphithéâtre en pierre décoré de statues basées sur des mythes romains comme la Fontaine de l'Océan sculptée par Giambologna, puis transférée dans un autre endroit du même jardin, la petite "Grotte de Madama", et la "Grande Grotte", commencée par Vasari et terminée par Ammannati et Buontalenti entre 1583 et 1593. Ces statues continuent d'être des exemples remarquables de l'architecture et de la culture maniériste. Décorée à l'intérieur et à l'extérieur de stalactites et dotée à l'origine de jeux d'eau et d'une végétation luxuriante, la fontaine est divisée en trois sections principales. La première a été décorée de fresques pour créer l'illusion d'une grotte naturelle, c'est-à-dire un refuge naturel pour permettre aux bergers de se protéger des animaux sauvages, et abritait à l'origine les prisonniers de Michel-Ange, qui ont été transférés à cet endroit après avoir fait partie de la collection des Médicis (les statues originales ont maintenant été remplacées par des copies). Les salles qui suivent exposent des sculptures de valeur comme la "Vénus au bain" de Giambologna et le groupe de "Pâris et Hellène" de Vincenzo de Rossi.
D'autres œuvres de grande valeur sont également situées dans la zone au-dessus de l'amphithéâtre. C'est là que se trouve la fontaine connue sous le nom de Fontaine de la "Fourchette" ou "Fontaine de Neptune", du nom de la sculpture de Stoldo Lorenzi située au centre de la fontaine qui semble tenir un grand trident. Dans le parc on trouve aussi les grandes statues de l'"Abondance", situées au sommet de la colline, commencées par Giambologna, pour représenter Jeanne d'Autriche, l'épouse de François Ier. La statue fut en réalité achevée en 1637 comme figure allégorique.
En parcourant le jardin en direction de Porta Romana, après le Prato dell`Uccellare, on trouve le Viottolone, une grande avenue bordée de cyprès et de statuettes qui mène à l'espace ouvert de l'Isolotto, commencé par Giulio et Alfonso Parigi en 1618. Au centre de l'espace, on peut admirer la fontaine de l'Océan de Giambologna, entourée de trois autres sculptures représentant les fleuves Nil, Gange et Euphrate. Tout autour, il y a d'autres statues basées sur des sujets classiques et populaires (appartenant aux XVIIe et XVIIIe siècles) comme celles qui représentent des groupes d'enfants jouant à des jeux traditionnels.
La maison des Lorraine a connu d'autres ajouts au XVIIIe siècle, comme le "Kaffeehaus" (1775), la "Maison des citronniers" (1777-1778), tous deux construits par Zanobi del Rosso et la "Palazzina della Meridiana" commencée en 1776 par Gaspero Paoletti. L'"obélisque" égyptien rapporté de Louxor a été placé à cet endroit en 1789.
Cete « Maison des citronniers » ou Limonaia est l’orangerie du Palais. Nous en avons déjà parlé dans la section consacrée aux inondations de 1966, puisque les large espaces de ce bâtiment, en hauteur par rapport aux rives de l’Arno servit de refuge pour des oeuvres de première importance, sauvées des eaux, dont le fameux Crucifix de Cimabue de la basilique Santa Croce.